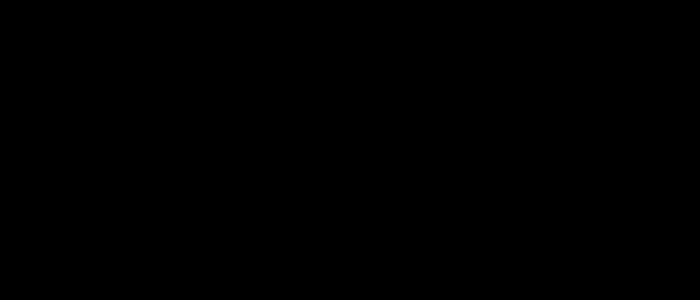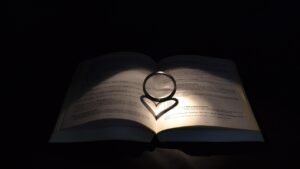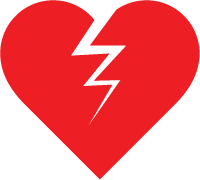Épisode 9 -Dr Walt Lillehei, M.D.
- Accueil
- »
- Histoire de la cardiologie
- »
- Épisode 9 -Dr Walt Lillehei, M.D.
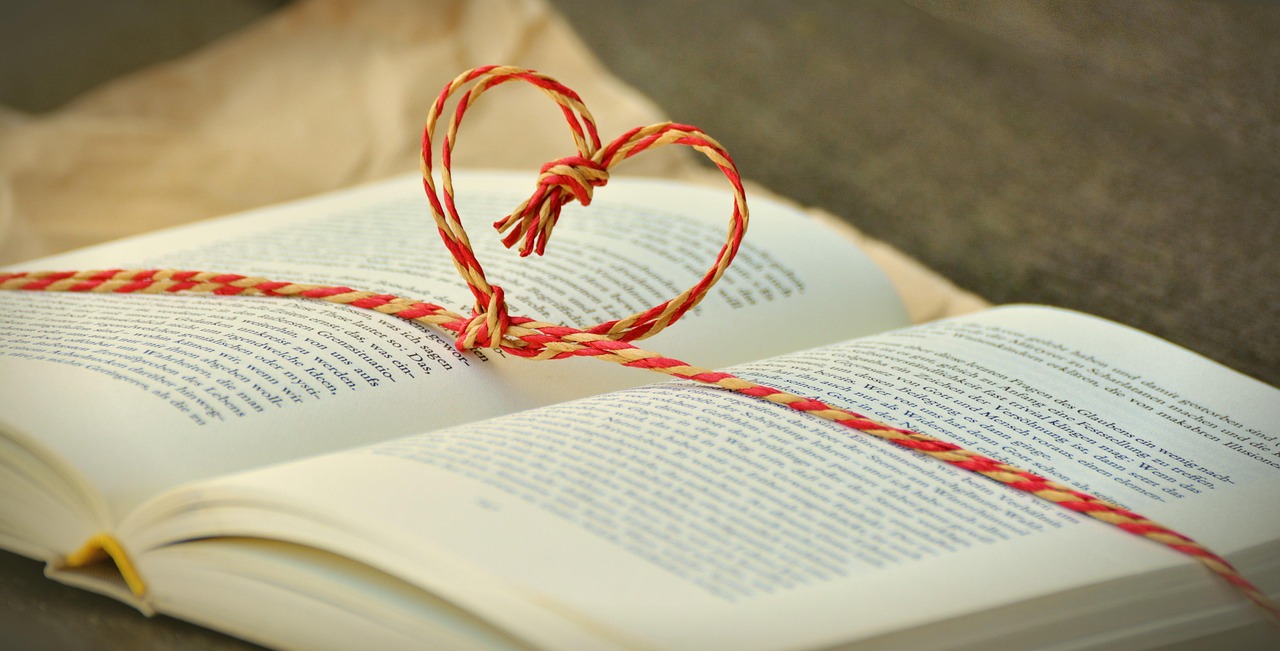
Dr Walt Lillehei, M.D.
Le défi de la chirurgie à cœur ouvert
Au début des années 1950, le monde médical cherche encore une technique permettant d’opérer à cœur ouvert tout en assurant l’oxygénation des organes.
L’hypothermie, qui permet d’arrêter la circulation quelques minutes, ne donne pas assez de temps pour réaliser des chirurgies complexes.
Le Dr Lillehei forme alors une équipe pour relever ce défi.
Une idée inspirée par la nature
Le point de départ vient de l’observation du fœtus : dans l’utérus, l’oxygénation se fait par la circulation maternelle, sans passer par les poumons. Le placenta, solidement attaché à l’utérus, est une structure hautement vascularisée ; un cordon composé de veines et d’une artère en ressort pour évacuer le gaz carbonique (CO₂) et apporter l’oxygène au sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> du fœtus.
Ce mécanisme inspire au Dr Lillehei et à son équipe l’idée audacieuse de reproduire ce principe hors de l’utérus : connecter un patient atteint d’une malformation cardiaque congénitale à la circulation sanguine de sa mère ou de son père pendant l’opération. Ce qui fonctionne dans l’utérus pourrait bien fonctionner à l’extérieur !

Mise au point de la « circulation croisée »
Pour concrétiser cette idée, l’équipe du Dr Lillehei se procure des tubes en plastique et une pompe à compression circulaire. Ce dispositif fonctionne grâce à une roulette qui tourne et comprime le tube rempli de sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >>, de façon rythmée et ajustable, pour propulser le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> vers l’avant.
Ce procédé présente un double avantage : le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> ne touche jamais les pièces mécaniques, ce qui réduit les risques de coagulation ou d’infection, et les tubes peuvent être jetés après usage, garantissant ainsi une meilleure sécurité sanitaire.
Les premiers essais sur animaux
La première expérimentation est réalisée sur deux chiens : l’un sert de donneur et l’autre de receveur. Les deux sont anesthésiés, puis reliés par la pompe pendant 30 minutes. Le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> du donneur est entièrement redirigé vers une veine du receveur, ce qui permet d’arrêter temporairement le cœur du donneur et de réaliser une chirurgie cardiaque. Le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> oxygéné du receveur retourne ensuite vers l’animal opéré par une artère.
Au réveil, les deux chiens se portent bien : l’essai est considéré comme une réussite, confirmant la faisabilité de cette approche innovante.
Encouragée par ce succès, l’équipe pousse plus loin l’expérimentation. Elle crée un modèle de réparation cardiaque : un trou est pratiqué entre les deux ventriculesLes ventricules sont les 2 cavités inférieures du cœur. Ils sont plus musclés que les oreillettes; ils servent à propulser le sang pour assurer la circulation dans tout le corps. >> du cœur d’un chien receveur. Une fois le chien donneur installé et la connexion par pompe établie, la réparation du septum est réalisée en 24 minutes.
Là encore, l’intervention se solde par un succès, les deux animaux récupérant sans complication apparente.

Première intervention humaine : Gregory Gitten
En mars 1954, le Dr Lillehei se prépare à réaliser une première mondiale : la réparation d’une communication interventriculaire (CIV) chez un enfant de 2 ans, Gregory Gitten.
- Débat éthique
L’opération repose sur la « circulation croisée », une méthode qui implique de connecter temporairement le patient à la circulation sanguine d’un parent. Or, cette approche place non pas une, mais deux vies en danger : celle du jeune patient et celle du donneur sain. Le risque combiné de mortalité est alors évalué à 200 %, un chiffre qui choque et déclenche un vif débat éthique.
Les opposants dénoncent le fait qu’une telle intervention, même motivée par l’urgence vitale, pourrait être moralement inacceptable. Les partisans rappellent qu’en l’absence de solution alternative, l’enfant est condamné à une mort certaine.
- Permission de procéder
Après de longues discussions et grâce à des appuis solides, l’hôpital finit par accorder une autorisation exceptionnelle. L’intervention est réalisée comme prévu : la communication interventriculaire est fermée, et le petit Gregory, tout comme sa mère donneuse, sort initialement indemne de la salle d’opération.
- Décès par complication
Malheureusement, la victoire sera de courte durée. Deux semaines après l’intervention, Gregory contracte une pneumonie sévère. À cette époque, les antibiotiques et les moyens de lutte contre les infections respiratoires restent limités, surtout chez les enfants fragilisés par une chirurgie lourde.
L’infection évolue rapidement et, malgré les soins prodigués, l’état du petit patient se détériore. Gregory s’éteint, laissant derrière lui une équipe bouleversée et une mère qui, quelques jours plus tôt, avait offert son propre sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> et risqué sa vie pour sauver celle de son fils.
Ce dénouement tragique n’efface toutefois pas la portée historique de l’intervention. Pour la première fois, une malformation cardiaque complexe avait été réparée à cœur ouvert grâce à la circulation croisée entre deux êtres humains. Cette avancée, même marquée par une perte, allait ouvrir la voie à de nouvelles techniques et à la poursuite de recherches qui transformeront la chirurgie cardiaque.
Le cas d’Annie Brown
Peu de temps après la première intervention humaine, un autre couple se présente au Dr Lillehei. Leur fille, Annie Brown, âgée de quatre ans, est atteinte d’une communication interventriculaire (CIV) importante. À chaque contraction de son cœur, une partie du sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> oxygéné passe du ventricule gauche vers le ventricule droit, surchargeant la circulation pulmonaire.
Cette situation provoque un excès de volume dans les poumons, favorisant des infections répétées et menaçant rapidement sa survie.
Annie est hospitalisée à maintes reprises pour des pneumonies sévères. Les analyses montrent que seul son père est compatible pour servir de donneur dans le cadre de la « circulation croisée ». L’intervention, initialement prévue, doit être reportée en raison d’un nouvel épisode infectieux.
- Une chirurgie réussie, mais non sans suspense
Lorsque l’opération peut enfin avoir lieu, la connexion avec le père est établie et le cœur d’Annie est ouvert. Le trou dans le septum ventriculaire est localisé et suturé. Mais à la fermeture du cœur, une complication survient : le rythme cardiaque reprend, mais de façon extrêmement lente.
Un bloc complet de la conduction électrique interrompt la transmission des impulsions vers les ventriculesLes ventricules sont les 2 cavités inférieures du cœur. Ils sont plus musclés que les oreillettes; ils servent à propulser le sang pour assurer la circulation dans tout le corps. >>, probablement en raison d’un point de suture placé près du système de conduction. À cette époque, aucun pacemaker n’existe pour pallier cette situation critique.
Après 90 longues secondes d’attente, le rythme normal revient spontanément, évitant une issue fatale. Le père et Annie se réveillent sans complication immédiate. Les suites postopératoires se déroulent sans incident, et la fillette peut enfin rentrer chez elle, libérée de l’obstacle cardiaque qui avait jusque-là compromis son avenir.

Résultats et complications
En neuf semaines, sept patients sont opérés avec cette méthode : un seul survit sans séquelle, les autres décèdent ou subissent un AVC.
Malgré tout, le Dr Lillehei réussit la première correction d’une tétralogie de Fallot.
La circulation croisée est finalement abandonnée, au profit d’autres techniques.
Héritage
Le Dr Walt Lillehei décède le 5 juillet 1999 à l’âge de 80 ans.
Pionnier audacieux, il aura ouvert la voie à la chirurgie cardiaque moderne.