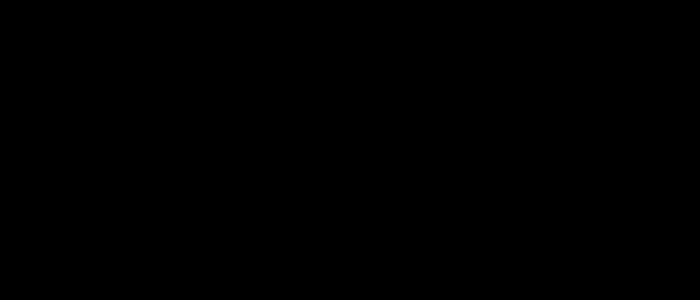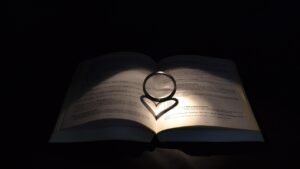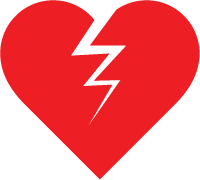Épisode 10 – John « Jack » Gibbon, M.D.
- Accueil
- »
- Histoire de la cardiologie
- »
- Épisode 10 – John « Jack » Gibbon, M.D.

Le père de la circulation extracorporelle
Né à Philadelphie en 1903, John Gibbon obtient son diplôme en chirurgie à l’Université Harvard, au Massachusetts.
Très tôt dans sa carrière, un événement marquant oriente sa destinée : au cours d’une opération pour retirer un caillot massif dans le poumon d’une patiente ayant fait une embolie pulmonaire après l’ablation de sa vésicule biliaire, il assiste impuissant à son décès. Gibbon affirmera par la suite qu’un appareil capable de détourner et d’oxygéner le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >> en dehors du corps aurait pu sauver cette vie.
Une idée visionnaire
Il se lance alors dans la conception d’une pompe capable de créer une circulation extracorporelle, c’est-à-dire un dispositif assurant à la fois :
- l’oxygénation du sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >>,
- la prévention de la formation de caillots,
- et la protection des globules rouges contre la destruction mécanique.
Ces trois conditions représentaient les obstacles majeurs à surmonter avant de rendre l’appareil fonctionnel.
Une collaboration familiale et scientifique
Pendant plus de dix ans, John Gibbon travaille avec son épouse Marjorie, qui partage son laboratoire et ses efforts. La Seconde Guerre mondiale interrompt leurs recherches : Gibbon est mobilisé comme chirurgien en Nouvelle-Calédonie.
À son retour, il reprend son projet et bénéficie du soutien technique des ingénieurs d’IBM. Ensemble, ils parviennent à développer le premier cœur-poumon artificiel répondant aux critères de sécurité nécessaires.

Le premier succès
En mai 1953, John Gibbon réalise la première chirurgie cardiaque réussie avec assistance circulatoire mécanique. Il corrige une communication interauriculaire (CIA) chez une jeune patiente de 18 ans, Martha Cowley.
L’intervention, qui dure 26 minutes, se déroule sans complication. La patiente quitte l’hôpital quelques jours plus tard : une première mondiale qui marque l’entrée de la chirurgie cardiaque dans une nouvelle ère.
Des échecs douloureux
Le triomphe sera de courte durée. Les deux interventions suivantes se soldent par le décès des patients. Ébranlée, la compagnie IBM annonce deux ans plus tard qu’elle abandonne le projet, prétextant un changement d’orientation. Gibbon lui-même suspend ses travaux cliniques.
La reprise par d’autres pionniers
Malgré cet arrêt, le principe de la circulation extracorporelle n’est pas abandonné. La clinique Mayo et d’autres centres reprennent et perfectionnent la technique.
Les progrès sont rapides : la mortalité opératoire cardiaque, qui atteignait encore 50 % en 1955, chute à 25 % en 1956, puis à 10 % en 1957. Aujourd’hui, selon le type de chirurgie et l’état de santé global du patient, elle est inférieure à 2 %.

Héritage
John Gibbon décède d’un infarctus du myocarde en 1973, à l’âge de 69 ans.
Son héritage perdure : la quasi-totalité des chirurgies cardiaques modernes utilisent la circulation extracorporelle (CEC). Dans le langage médical, on dit encore que « le patient est sous pompe ».