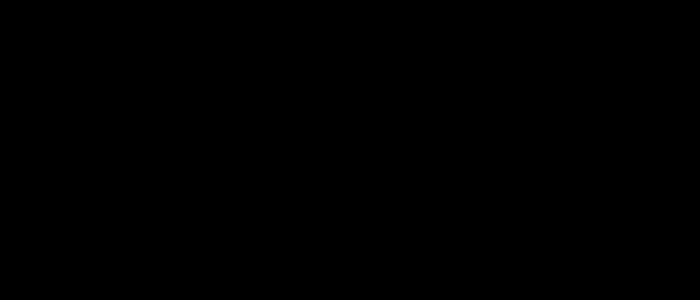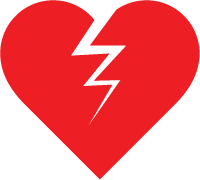Cardiologie environnementale
- Accueil
- »
- Cardiologie environnementale
- »
- Cardiologie environnementale

La cardiologie environnementale étudie l’impact du milieu de vie sur la santé du cœur.
Depuis longtemps, nous savons que certains facteurs augmentent le risque de maladies cardiaques. On les classe habituellement en deux catégories :
- Facteurs non modifiables : âge, sexe masculin, antécédents familiaux.
- Facteurs modifiables : tabagisme, sédentarité, excès de poids, diabète, hypertension artérielle.
Aujourd’hui, un autre élément s’ajoute à la liste des facteurs modifiables : l’environnement dans lequel nous vivons. Celui-ci influence directement notre santé cardiovasculaire.
L'impact environnemental
La mondialisation de l’information nous permet de suivre presque en temps réel les statistiques sur les maladies et les décès cardiovasculaires dans le monde.
En comparant les données d’une région ou d’un pays à l’autre, on constate des écarts parfois importants : pourquoi, par exemple, les habitants d’une région donnée sont-ils plus souvent touchés par les maladies cardiovasculaires ? Pourquoi y a-t-il plus (ou moins) de décès ?
Ces différences s’expliquent en grande partie par deux éléments : les habitudes alimentaires et l’environnement. Ces liens sont aujourd’hui bien documentés et méritent d’être explorés.
Grandes différences de mortalité cardiovasculaire entre les pays
Il y a quelques années, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié des données frappantes : chez les hommes âgés de 25 à 64 ans, le taux de mortalité cardiovasculaire en Russie et en Ukraine est 11 fois plus élevé que chez les Suisses et les Espagnols.
Une telle différence ne peut pas s’expliquer uniquement par les facteurs de risque classiques.
Facteurs de risque traditionnels… et nouveau venu
Les facteurs de risque bien connus incluent l’hérédité, le tabagisme, le diabète, l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle, l’excès de poids et la sédentarité.
Pendant longtemps, la médecine s’est concentrée sur ces aspects familiaux et individuels. Aujourd’hui, un autre joueur prend de plus en plus de place : l’environnement.
Révolutions industrielles et vagues de mortalité
En observant l’histoire, on constate que les maladies cardiovasculaires étaient beaucoup moins fréquentes avant l’ère industrielle. Entre 1900 et 1950, par exemple, le nombre d’infarctus a quadruplé aux États-Unis, alors qu’il restait faible dans les régions non industrialisées.
Chaque révolution industrielle a vu arriver une vague de mortalité cardiovasculaire. Trois types de facteurs environnementaux y ont largement contribué :
- Les nano-agresseurs aériens : de minuscules particules polluantes présentes dans l’air, invisibles à l’œil nu, qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons et passer dans le sangLe sang est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes et de plasma. Les globules rouges sont responsables du transport de l’oxygène et du dioxyde de carbone. Les globules blancs constituent notre système de défense >>.
- Les nano-agresseurs alimentaires : certains additifs industriels ou contaminants qui, consommés régulièrement, perturbent le fonctionnement du cœur et des vaisseaux.
- La minéralisation urbaine : la disparition progressive des espaces verts au profit du béton, ce qui entraîne moins d’activité physique, plus de chaleur en été et une moins bonne qualité de l’air.
Pollution de l’air : un coupable majeur
En mars 2014, l’OMS a révélé que la pollution de l’air est responsable de 7 millions de décès par an dans le monde — soit un décès sur huit.
On pense souvent aux pays en développement, mais les pays industrialisés sont aussi concernés.
Par exemple, en 2008, au Canada, on estimait à 20 000 le nombre de décès supplémentaires attribuables à la pollution atmosphérique, pour un coût évalué à 9,1 milliards de dollars en soins de santé.

Décès excédentaires : comprendre le calcul
Le terme décès excédentaire désigne le nombre de décès supplémentaires observés par rapport au nombre normalement attendu dans une population atteinte d’une maladie du cœur.
Pour calculer ce chiffre, on commence par estimer combien de personnes devraient, en moyenne, décéder en fonction du nombre de malades et du taux de mortalité habituellement observé.
Exemple concret :
Si une maladie cardiovasculaire présente un taux de mortalité annuel de 5 %, cela signifie que, pour 1 000 personnes atteintes, on s’attend en moyenne à 50 décès par année.
Si, dans cette même année, on observe 75 décès réels, on parle alors de 25 décès excédentaires.
Autrement dit, ces 25 décès de plus que prévu représentent un signal : il y a probablement un ou plusieurs facteurs additionnels — comme la pollution, la chaleur extrême, ou d’autres éléments environnementaux — qui aggravent la situation.
Stress oxydatif et inflammation : un duo néfaste pour le cœur
Les mécanismes par lesquels les polluants atmosphériques peuvent provoquer un infarctus, un AVC ou même une mort subite sont maintenant bien documentés. Deux phénomènes clés sont en cause : le stress oxydatif et l’inflammation qu’il entraîne.
Pour vulgariser le concept de stress oxydatif, on peut imaginer que chaque cellule de notre corps possède de petites « centrales d’énergie ». En produisant cette énergie, elles libèrent aussi des sous-produits indésirables appelés radicaux libres — un peu comme une centrale électrique qui génère aussi de la fumée. Normalement, notre organisme dispose de boucliers protecteurs, appelés antioxydants, qui neutralisent ces radicaux libres.
Le problème survient lorsque la production de radicaux libres dépasse la capacité de défense des antioxydants. Ce déséquilibre endommage les cellules et provoque une réaction en chaîne : inflammation, dysfonctionnement des vaisseaux sanguins, formation de caillots… autant de conditions qui augmentent le risque d’événements cardiovasculaires graves.
L’amélioration de la qualité de l’air : des victoires… mais un chemin encore long
En 2014, Montréal et Toronto ont vécu un été sans smog pour la première fois depuis que ces relevés existent. L’Université de Toronto avait alors estimé que cette amélioration avait permis de réduire les décès excédentaires liés à la pollution (1 300 contre 1 700 en 2004) et les hospitalisations (3 550 contre 6 000). Cette victoire avait été attribuée notamment à la fermeture des centrales au charbon et au programme « Drive Clean » de l’Ontario.
Une avancée similaire avait été observée dans les années 1980, lorsque le plomb a été éliminé de l’essence. Les concentrations atmosphériques ont alors chuté au point que le Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air (RSQA) de Montréal ne les mesure même plus.
Mais le contexte actuel rappelle que la lutte est loin d’être terminée.
L’été 2025 a été marqué par une dégradation importante de la qualité de l’air à Montréal et à Toronto, due aux feux de forêt dans le nord et l’ouest du pays. Certaines journées, ces deux métropoles se sont hissées parmi les villes les plus polluées au monde.
Historiquement, seule une journée sur trois au centre-ville de Montréal présentait un indice de qualité de l’air jugé « bon » (IQA < 25). Passer d’un air « bon » à « passable » (IQA 25–50) n’est pas anodin : une étude de Harvard a montré que ce simple changement augmente le risque d’AVC de 35 % à 50 %.

Pollution alimentaire : un autre agresseur invisible
En plus des nano-agresseurs aériens provenant des combustibles fossiles, notre quotidien est envahi par des nano-agresseurs alimentaires, principalement sous la forme d’additifs industriels.
Parmi la multitude de molécules introduites dans notre alimentation, certaines sont particulièrement nocives : l’excès de sel omniprésent, les gras trans et les sucres ajoutés industriels.
Leur consommation répétée entraîne une cascade de problèmes : hypertension artérielle, déséquilibres lipidiques, syndrome métabolique (un état proche du diabète), obésité… autant de portes d’entrée vers l’infarctus et l’AVC.
À cela s’ajoute un environnement publicitaire qui rend ces produits difficiles à éviter : un enfant est exposé à environ 30 000 messages publicitaires de malbouffe avant l’âge adulte. Les distributrices de boissons sucrées dans les écoles, bien que progressivement retirées, et la prolifération des restaurants rapides près des lieux de vie accentuent encore le problème. Les recommandations des associations de santé publique peinent à s’imposer face à cette réalité.
Pollution atmosphérique et alimentation : un effet amplificateur
Lorsque la pollution de l’air et la malbouffe industrielle agissent ensemble, c’est la « tempête vasculaire parfaite ». Les études sont sans appel : des expériences ont montré que des souris exposées simultanément à un régime riche en graisses de type fast-food et à de l’air pollué développent des plaques massives d’athérosclérose dans leurs artères.
Autrement dit, pollution atmosphérique et alimentation industrielle ne s’additionnent pas simplement — elles se renforcent mutuellement, multipliant les risques cardiovasculaires.

Milieu urbain bétonné
Le milieu urbain s’étend et se minéralise, c’est-à-dire que les surfaces naturelles cèdent la place à des matériaux comme le béton ou l’asphalte. Ces revêtements retiennent la chaleur, limitent l’infiltration de l’eau et réduisent la présence de zones vertes. Cela favorise l’apparition d’îlots de chaleur urbains, de pics de smog, d’un air moins filtré et tempéré par la végétation, ainsi que de problèmes de ruissellement et de drainage.
Dans ces environnements appauvris en verdure, la chaleur s’accumule et persiste, mettant à l’épreuve la capacité du corps à réguler sa température.
Comment le corps régule la température corporelle
Pour comprendre l’impact de la chaleur sur l’organisme, on peut comparer le corps humain à un système de refroidissement : un climatiseur capte la chaleur intérieure et l’évacue vers l’extérieur à l’aide d’une pompe, un système de circulation de fluide et d’un ventilateur.
Chez l’humain, c’est le centre thermorégulateur du cerveau (l’hypothalamus) qui agit comme un thermostat, maintenant la température interne autour de 37 °C.
En situation de stress thermique — lorsque la chaleur ambiante dépasse ce que le corps peut facilement compenser — le cœur accélère afin d’augmenter la circulation vers la peau. Celle-ci agit comme un échangeur, dissipant la chaleur grâce à la vasodilatation (augmentation du débit sanguin en surface) et à la transpiration (évaporation de la sueur).
Ce mécanisme permet de stabiliser la température corporelle, mais impose un effort supplémentaire au cœur, surtout lors des canicules, d’efforts physiques ou chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires.
Dans les grandes villes, l’abondance de béton et d’asphalte aggrave la situation : ces surfaces accumulent la chaleur le jour et la relâchent la nuit, prolongeant ainsi le stress thermique.
Chez les personnes vulnérables, ces mécanismes d’adaptation peuvent rapidement atteindre leurs limites, ce qui explique pourquoi les vagues de chaleur constituent un risque cardiovasculaire majeur dans les zones urbaines fortement minéralisées.
Impact fracassant des canicules en France : données anciennes et réalités récentes
En août 2003, la France a connu un véritable tournant sanitaire. Des températures extrêmes ont provoqué plus de 20 000 décès excédentaires, particulièrement dans les zones urbaines dépourvues de végétation.
L’impact a été si brutal que les morgues parisiennes se sont retrouvées saturées et que des corps ont dû être entreposés dans des congélateurs industriels. Cet épisode a même entraîné, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un recul de l’espérance de vie dans le pays, soulignant l’urgence d’agir contre les îlots de chaleur urbains.
- Du choc de 2003 aux années suivantes
Cet événement a servi d’électrochoc, poussant les autorités à mettre en place des plans nationaux canicule, à renforcer la surveillance sanitaire et à développer des stratégies d’adaptation. Malgré ces efforts, la chaleur extrême reste un ennemi redoutable.
- Des canicules toujours meurtrières
Depuis 2015, les vagues de chaleur continuent de provoquer plusieurs milliers de décès chaque année en France et en Europe. Les étés 2022 et 2023 figurent parmi les plus meurtriers depuis 2003, avec des températures records et un impact particulièrement marqué dans les zones urbaines dépourvues de verdure.
La fréquence et l’intensité croissantes de ces épisodes, amplifiées par le changement climatique, confirment que la prévention et l’adaptation restent plus que jamais essentielles.
Importance du milieu vert
La prise de conscience de l’ampleur de la déforestation — la moitié des forêts de la planète ayant déjà disparu — a mis en lumière le rôle essentiel des arbres dans nos milieux de vie.
En ville comme en campagne, ils contribuent à l’harmonie visuelle, au bien-être psychologique et physique, à la régulation du climat, à la réduction des coûts énergétiques des bâtiments, ainsi qu’à la purification de l’air en captant et en transformant les polluants.
De nombreuses études confirment les effets positifs du couvert végétal sur la santé. Parmi elles, une recherche d’envergure menée en Écosse, portant sur 40 millions d’habitants du Royaume-Uni, a montré qu’en seulement cinq ans, les zones les plus vertes enregistraient une réduction de 6 % de la mortalité cardiovasculaire, et ce, toutes classes sociales confondues.
Trois mécanismes principaux expliquent ces bénéfices :
- une pollution atmosphérique moindre dans les espaces verts,
- une meilleure filtration et épuration de l’air grâce aux arbres,
- un effet biologique direct de certaines protéinesLes protéines sont des éléments fondamentaux fabriqués par les cellules de notre corps. Elles jouent un rôle essentiel dans de nombreuses fonctions biologiques, agissant comme des hormones, des anticorps, et même des transporteurs de cholestérol, entre autres. produites par la végétation sur notre organisme.

Lien avec la cardiologie environnementale
Ces résultats démontrent que la présence d’espaces verts n’est pas qu’une question d’esthétique urbaine : elle a un impact mesurable sur la santé du cœur et des vaisseaux. La cardiologie environnementale rappelle que le milieu dans lequel nous vivons influence directement notre risque cardiovasculaire.
Protéger et développer les zones végétalisées devient donc un acte de prévention au même titre que lutter contre le tabagisme, l’inactivité physique ou la mauvaise alimentation.
En ce sens, l’argumentaire de la santé rejoint celui des changements climatiques : moins de combustibles fossiles et plus d’arbres, pour la planète… et pour le cœur.
Centres hospitaliers : soins et exemple à donner
Les centres hospitaliers, en tant qu’acteurs majeurs de la santé publique, peuvent jouer un rôle clé, à la fois par les soins qu’ils prodiguent et par leur engagement envers un environnement plus sain.
C’est dans cette optique qu’émerge le concept d’« hôpital vert ». De plus en plus, on s’intéresse à l’empreinte écologique des bâtiments, à la réduction des polluants et à l’adoption de solutions durables.
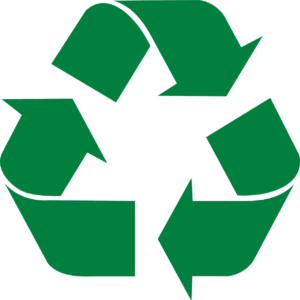
Le mandat global du gouvernement du Québec prévoit que tous les ministères et organismes intègrent des stratégies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et autres polluants, tout en appliquant les « 3R » — réduction, réemploi, recyclage.
Les hôpitaux, qui représentent à eux seuls environ 2 % des émissions nationales de GES, sont directement concernés.
- Journée de l’arbre de la santé
Un exemple inspirant est la Journée de l’arbre de la santé, lancée en 2008 à l’Hôpital de la Cité de la Santé à Laval et aujourd’hui présente à Sherbrooke, Val-d’Or, Trois-Rivières et Lanaudière — une idée qui fait des petits !
Lors de cette journée, de petits arbustes sont plantés sur le terrain des hôpitaux, que ce soit dans un jardin, un aménagement paysager, un espace vert attenant ou même dans les zones de stationnement.
L’événement illustre comment les institutions de santé peuvent allier soins, prévention et responsabilité environnementale, tout en rappelant les liens étroits entre un milieu sain et la santé cardiovasculaire.

Gestes individuels, force collective
Malgré les soubresauts politico-administratifs, il appartient aux administrateurs hospitaliers et aux médecins d’intégrer ces nouvelles connaissances dans leurs décisions, afin de rejoindre les efforts déployés par les gouvernements et les entreprises.
Chaque geste individuel contribue à renforcer la dynamique collective.
Pensons globalement, agissons localement.